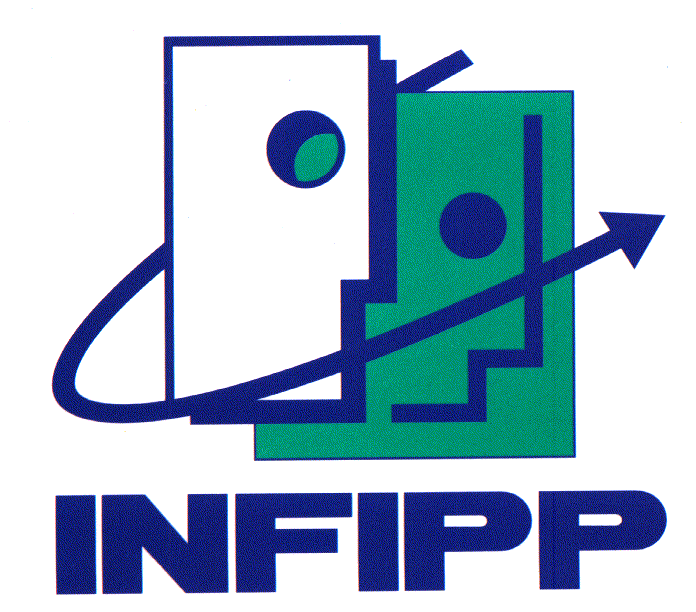
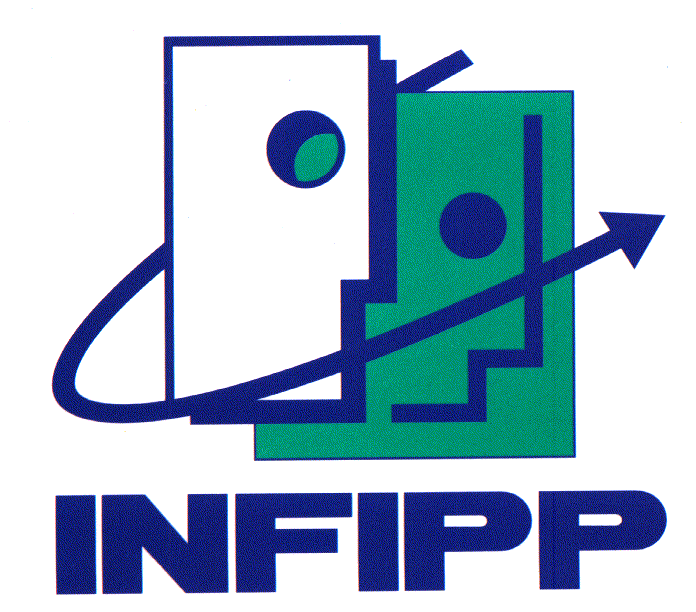
Département: relation d’aide centrée sur la personne et technique d’entretien.
NON, JEF T'ES PAS TOUT SEUL !
En quoi l'approche centrée sur la personne
me permet une meilleure écoute des alcoolodépendants.
Mémoire en vue de l’obtention du
certificat de praticien en relation d’aide à visée thérapeutique,
soutenu publiquement le mercredi 1er décembre 1999 à Chenôve par
Pascal COURTY
Membres du jury :
![]()
Téléchargement du texte en format Word 6 (204 ko)
Téléchargement du texte en format Word 6 compressé avec Winzip7 (53 ko)
Téléchargement du texte en format HTML compressé avec Winzip7 (39 ko)
Téléchargement intégral au format PDF avec photos et tableaux (1132 ko)
![]()
1. INTRODUCTION
1.1. La formation.
1.2. Le mémoire.
1.3. Le stage pratique.
2.LE CONTEXTE
2.1. Mon champ
professionnel
2.2. Le stage pratique
2.3. Ma pratique des entretiens
3.CONCEPTS THEORIQUES
3.1. Quels
mots pour quelle rencontre ?
3.2. Quels maux ?
4. ANALYSE DE MA PRATIQUE
de l'approche centrée sur la
personne
4.1. Idées générales
4.2. Premières constatations
4.3. L'exploration des sentiments
4.4. La congruence
4.5. L'empathie
4.6. La présence
4.7. L'effet libérateur
4.8. les silences
4.9. Ecouter pour entendre
4.10. La résistance
4.11. La souffrance
4.12. Besoin de l'autre
4.13. L'alcool
4.14. Le groupe
4.15. Divers
4.16. La supervision
![]()
Je remercie ici tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de ma formation.
Une mention spéciale pour le Dr BRUNET qui m'a accueilli pendant 6 mois dans son cabinet, et auprès de qui j'ai tant appris.
Je remercie tout particulièrement les personnes que j'ai essayé d'accompagner pendant la durée de ma formation. Elles ont eu à subir, plus que tout autre, mes absences du service, mes visites avec mon magnétophone, ma réflexion, parfois obsessionnelle, sur l'alcoolisme, mes certitudes et mes incertitudes. Elles ont été pour moi une source d'enrichissement personnel et professionnel.
Tous ont favorisé, qu'ils aient été pour moi des échecs ou des succès, la connaissance du processus de traitement. De leur lutte vers l'épanouissement, le développement et la maturité, s'est imposé la certitude que nous possédons trop peu de foi dans les capacités de croissance de l'individu.
![]()
Ma pratique des entretiens dans le cadre de l'accompagnement social de personnes alcooliques n’était pas sans me poser question :
Pourquoi certaines personnes croisaient un jour le produit alcool pour finir par ne plus pouvoir s’en passer ?
Qu’est-ce qui fait que l’on devient dépendant à l’alcool ?
Comment faire pour s’en sortir ?
Dès mes premières rencontres avec des personnes alcooliques, je
cherchais des réponses à ces questions.
Mon travail consiste à faire de la réadaptation sociale en milieu ouvert au service
de suite. Trouver un logement, un stage ou un emploi n’est pas trop
compliqué, si "on est bien dans sa tête". Mais si la personne ne s'est pas
libérée de l'éthylisme, tous les efforts pour cela sont pratiquement voués à
l'échec.
Les rechutes sont nombreuses, beaucoup trop nombreuses et la
réflexion quasi inexistante dans l’institution où je travaille.
1.1. La formation.
Pourquoi faire une formation sur "l'entretien dans la relation
d'aide à visée thérapeutique" ?
L’idée qu’il y avait du psychologique dans l'alcoolisme m’a amené à
effectuer un stage au Centre de Libération du Mal-être Éthylique (C.A.L.M.E.). Ce stage
consistait à suivre un groupe de patients pendant les 29 jours de leur cure spécialisée
avec psychothérapie. Au cours de cette expérience, j’ai pu me rendre compte de
l’importance du travail en groupe de parole avec des «psycho » .
A mon retour, j’en étais persuadé, la psychothérapie était une solution.
L'expression permet de diminuer la souffrance psychique. Comme je ne me sentais pas capable d'aider ces personnes dépendantes, j’ai incité beaucoup de personnes à "aller voir un psy". Comme on ne va pas voir un médecin-des-fous sur un coup de baguette magique et encore moins parce que l’éducateur pense que c’est bien pour vous, il m’a fallu commencer à écouter un peu plus les personnes qui venaient vers moi.
A force de recadrage personnel et d’analyse de ma pratique, les personnes me parlaient de plus en plus. Elles me fournissaient des matériaux mais je ne savais qu’en faire. Je leur disais souvent qu’il faudrait qu’elles répètent ce qu’elles me disaient à un psy parce que moi je ne pouvais pas aller plus loin avec elle. Certaines, après avoir éprouvé une certaine avancée dans la compréhension de leurs problèmes, et avoir "goûté" à la libération par la parole, se décidaient à faire la démarche vers une psychothérapie. Mais peu, encore trop peu.
Comment faire ?
Avec tout ce que je pouvais entendre d’elles, avec la parole libérée il me faudrait sans doute aller plus loin.
La solution était de me former. J’ai donc choisi la formation de l’INFIPP sur Chenôve. (Commune où je réside, pour que les frais soient moindres et que ma formation aie plus de chance d'être acceptée par mon employeur.)
1.2. Le mémoire.
Dès que j’ai vu dans la formation qu’un mémoire pouvait être réalisé, je m'y suis lancé, un peu comme un défi.
Sans doute ma qualité de moniteur de stage pour des éducateurs spécialisés en dernière année de formation, période pendant laquelle je travaille avec eux sur leur mémoire, m'a donné envie d’écrire mon propre mémoire. L'écriture du mémoire m'a amené à faire tout un travail de recherche sur l'alcoolisme et l'approche centrée sur la personne.
J'ai fait des recherches qui ne sont pas toutes - loin de là ! - retranscrites dans ces quelques pages. Des recherches sur l'alcoolisme dans la chanson française, la publicité, la peinture, les timbres, sur l'apparition de la parole comme thérapie dans l'histoire du traitement de l'alcoolisme, et sur ce qu'était l'approche centrée sur la personne, la psychothérapie…
1.3. Le stage pratique.
Bien que je pratique des entretiens quotidiennement dans le cadre de mon travail, j'ai souhaité effectuer un stage pour "voir ailleurs". J'ai tout naturellement choisi le Centre de Cure Ambulatoire en d'Alcoologie. J'ai effectué ce stage sur une longue durée, de janvier à juin, pour mieux m'imprégner du travail. Ce stage s'est déroulé en deux temps :
Le premier avec un des deux médecins qui m'a accepté dans son bureau tous les mercredis matins pendant ses consultations.
Le deuxième pendant deux mois avec le psychothérapeute.
Durkeim nous apprend que "si nous comprenons mieux les alcooliques, peut-être notre capacité à les aider sera-t-elle plus efficace". C'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ce travail.
J'ai cherché à comprendre pourquoi la verbalisation du problème alcool était si difficile, et comment en utilisant l'approche centrée sur la personne je pouvais aider l'alcoolodépendant à diminuer sa souffrance psychique.
Nous allons d'abord étudier dans quel contexte j'ai réalisé mes observations et examiner la situation d'entretien telle que je la pratique et les difficultés que je rencontre : comment mettre des mots sur les maux ?
Je vais expliquer dans la deuxième partie de quels «mots » je parle, en définissant ce qu’est la relation d’aide et quelles sont les conditions pour la pratiquer. Puis de quels «maux » il est question ici, en définissant brièvement ce qu’est pour moi l’alcoolisme et surtout comprendre pourquoi l'alcool empêche de parler.
Ensuite je vous propose l'analyse de ma pratique de l'approche centrée sur la personne ainsi que les hypothèses d'actions que je peux mettre en place afin que mon action soit plus aidante.
L’expérimentation de l'approche centrée sur la personne a été faite sur deux terrains légèrement différents, même si la population, les alcoolodépendants, est de ce point de vue la même.
Il s’agit de mon champ professionnel et d'une période de stage pratique.
2.1. Mon champ professionnel
Je travaille, depuis 7 ans, dans un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale spécialisé dans l’accueil de malades alcooliques.
Ce CHRS compte trois services :
Le service post-sevrage qui accueille pour un programme de 6 semaines une dizaine de personnes à la suite d’un sevrage ou d’une cure de désintoxication.
A la suite du post-sevrage, les personnes peuvent intégrer le service hébergement. Ce service d’une capacité de 50 lits s’occupe de la réinsertion sociale des résidents. Les temps de séjour varient de quelques semaines à plusieurs années. La moyenne statistique est de 18 mois.
A leur sortie du service hébergement, les personnes peuvent demander un accompagnement social par le service de suite. Ce service est agréé pour accueillir 30 personnes accompagnées par deux éducateurs. La vocation de ce dernier est le suivi de personnes en appartement. C'est dans ce service que je travaille.
2.2. Le stage pratique
Le deuxième terrain d’expérimentation a consisté en un stage pratique au Centre de Cure Ambulatoire et d'Alcoologie de Dijon. Mon stage s’est déroulé de janvier à juin 99, 2h par semaine, auprès du médecin alcoologue. Pendant ce stage j’ai été plutôt observateur de la pratique du médecin. J'ai également travaillé avec le psychothérapeute pendant deux mois. Ce stage a été très enrichissant pour moi.
2.3. Ma pratique des entretiens
J’utilise l’entretien individuel depuis plusieurs années déjà.
Je co-anime deux groupes de paroles par mois au cours desquels je mets en pratique l'approche centrée sur la personne. Mais mon expérimentation s'est faite surtout lors des entretiens individuels.
La rencontre avec les personnes accueillies s'opère soit lors de leur passage au bureau du service pendant les permanences, soit lors d'entretiens, à leur domicile ou au bureau du service. Ces entretiens sont prévus à date fixe et sont obligatoires. Le protocole est codifié dans le contrat d’accompagnement social :
Dijon le, |
Au départ l'organisation des rendez-vous me servait surtout de contrainte personnelle. Aller voir quelqu’un le soir quand il pleut et que la journée a déjà été bien chargée, ce n’est pas encourageant. Si je ne savais pas qu’il ou elle m’attendait, si je n'avais pas "rendez-vous" je remettais la visite à plus tard. Cela avait également pour but de planifier la durée de l'entretien.
Maintenant la raison principale du fonctionnement à dates fixes est qu'il permet à chacun, la personne suivie et moi-même, d’avoir des repères dans l’espace (le lieu des visites différent) et dans le temps (les jours et heures fixes)
Chacun sait que l’autre a rendez-vous avec lui. Donc je compte pour lui, il pense à moi.
Dans la majorité des cas, je suis attendu. Les oublis sont très rares. Les absences le sont moins, mais ont très souvent une signification !
J’ai connu un homme qui a mis 4 mois avant de pouvoir être présent à son domicile ! Lors de mes visites, je laisse toujours une carte postale du foyer pour marquer mon passage, avec un petit mot. A chaque fois il vérifiait si j’étais bien venu. Il me dira plus tard qu’il n’avait jamais oublié les visites mais voulait vérifier si je venais quand même à chaque fois ou si j’abandonnerais (je l’abandonnerais ?)
Une mère de famille avec deux enfants à charge m’attend un mercredi sur deux. Elle dit que j’exerce mon droit de visite !
Une autre me fait dire par plusieurs personnes que j’ai loupé ma visite. Je commence à m’inquiéter et après vérification c’est elle qui s’est trompée dans notre calendrier. Je lui rends quant même visite et elle me dit «tu vois si je me suis trompée c’est sans doute que j’avais besoin de te voir ! »
L’endroit où se déroule l’entretien m’est très vite apparu important.
2.3.1. Au service.
Actuellement les entretiens se déroulent dans une pièce réservée à cela. Nous avons un autre bureau qui nous sert de lieu de travail. Ce n'était pas le cas auparavant.
Le bureau pour les entretiens est aménagé sommairement. Une table adossée au mur, une porte-fenêtre d’un coté et une étagère de l’autre.
Au début ma place et la place de l’accueilli n’étaient pas définies. Si la personne se trouvait face à la porte-fenêtre, elle était souvent distraite par les passages dans la rue. J’ai donc choisi cette place et la personne assise en face de moi pouvait s’inspirer des bibelots sur l’étagère en face.
Lors des premiers entretiens, je répondais au téléphone. Je pensais qu’il pouvait y avoir des appels plus urgents que l’entretien que j’avais à ce moment là. J’ai rapidement mis fin à cette pratique en utilisant le répondeur enregistreur, de façon à être présent à la personne présente.
Je ne peux pas parler des entretiens que je fais sans parler du vocabulaire employé par les personnes accueillies.
Certaines parlent de passer au tourniquet (Supplice du moyen âge !) d’autres parlent de leur rendez-vous, d’autres encore disent on se voit ; quand est-ce qu’on voit tous les deux ? Aucune ne parlait d'entretien au début. Maintenant ce mot est entré dans leur vocabulaire.
Dès le début de la formation, j’ai introduit le terme de rencontre pour évoquer les entretiens. J'avais de plus en plus de mal avec le mot "rendez-vous" et son double sens. (Rendez-vous ! Vous êtes cernés !)
A la fin d'une rencontre, la prochaine est rappelée et je leur laisse ce carton :
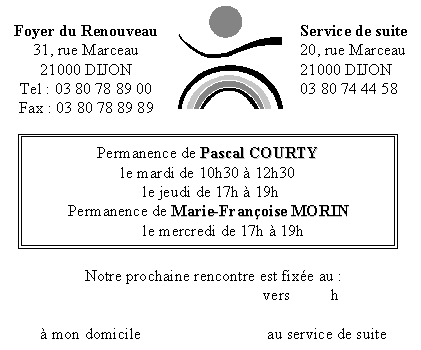 |
2.3.2. A domicile
Là ce n'est pas souvent moi qui ai le choix du lieu. (Quoique ?)
Je refuse les entretiens dans la chambre (quand il y a d’autres possibilités). Je me suis déjà retrouvé assis sur le lit avec des personnes en difficulté. J’évite au maximum de me retrouver dans cette situation.
Quand l’appartement le permet soit la personne qui m’accueille me propose «on se met dans la cuisine ou dans la salle ? »
Soit, elle m’invite dans un endroit ou dans l’autre suivant son choix. Le choix du lieu n’est pas anodin. J’ai remarqué que, chez certaines personnes, si celle-ci voulait une visite sympa c’est la salle, si c’est un entretien c’est plus souvent la cuisine.
Chez d'autres personnes, l’entretien se déroule toujours dans la même pièce et j’ai toujours la même place.
Certaines fois, quand ça va mal, la personne m'ouvre et part devant moi, souvent pour s'installer devant la télé sur le canapé. L' «entretien » est déjà commencé. Au cas où je n'aurais pas remarqué son mal être, elle me le montre bien.
J'ai réalisé les observations qui m'ont permis d'écrire ce mémoire sur environ une année, avec les personnes que j'ai accompagnées. Soit environ 25 personnes à raison de trois entretiens mensuels en moyenne. J'ai beaucoup enregistré d'entretiens. Le magnétophone a été assez bien accepté par les personnes qui allaient bien. Quand elles se sentaient plus mal, elles refusaient les enregistrements de nos conversations.
J'ai également utilisé le magnétophone à la fin des rencontres, il me permettait de me rappeler les principaux temps forts de l'entretien. Je les enregistrais alors dans la voiture ou dans mon bureau après l'entretien.
![]()
On demande toujours aux alcooliques de parler de leur alcoolisation, or ils n'en parlent pas spontanément, et pourtant, tout le monde a l’air d’accord pour dire que la parole libère :
"comment s'étonner que ceux qui se sont perdus par la bouche se servent de leur bouche maintenant pour renaître ? " Anne V
"Du confessionnal catholique à la psychanalyse, nous ne sommes pas les premiers à avoir constaté l'absolue nécessité de la parole pour exorciser la souffrance, la culpabilité, la honte, pour les élaborer, pour en arriver à en faire naître autre chose. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette mise en mots." Les Alcooliques Anonymes
"Il est en effet des moments où il (l’alcoolique) aurait besoin de parler, surtout dans cette période difficile où il commence à ressentir son incapacité à s'arrêter seul. Comme toujours, l'impuissance de la parole est la source de tous les conflits avec un entourage dont il a de plus en plus besoin." Rainaut et Morenon :
"L’alcoolique s’administre la mort par les moyens de la jouissance. Le plaisir de la bouche est le plus archaïque de notre économie libidinale puisqu’il remonte aux premières heures de notre existence et que le souvenir qu’il laisse est indélébile."
"L'alcoolique serait-il dépourvu du don de la parole" s'interroge J. Clavreul
L'alcoolisme s'appelle aussi un "mal être éthylique", j'essaie de leur proposer un "mieux vivre", en utilisant l'abstinence non comme un but mais comme un moyen pour une vie plus satisfaisante.
3.2. Quels mots pour quelle rencontre ?
Mucchielli définit l’entretien : "Le bon entretien a pour objectif la compréhension exacte de ce qui se passe pour l’Autre, la découverte de la manière dont il éprouve la situation, la clarification progressive de son vécu. L’intention de bien conduire l’entretien ne suffit pas. Il faut une méthode."
3.2.1. L’approche centrée sur la personne.
Carl Rogers, créa ce que l'on appelle "la psychothérapie centrée sur le client", un client est une personne qui n’est pas à priori "malade", dans le terme client il y aussi la notion d’échange si importante. Cette méthode est axée sur l'usage que le client fait de la relation avec son thérapeute.
« L’un des concepts les plus révolutionnaires qui ait émergé de notre expérience clinique réside dans la reconnaissance croissante que le noyau le plus central de la nature humaine, les couches les plus profondes de sa personnalité, la base de sa «nature animale », est positif par nature ; fondamentalement socialisé, allant de l’avant, rationnel et réaliste."
3.2.2. La relation d’aide
Rogers nous dit qu’il entend par ce terme des relations dans lesquelles l'un au moins des deux protagonistes cherche à favoriser chez l'autre la croissance, le développement du vécu, la maturité, un meilleur fonctionnement et une plus grande capacité à affronter la vie.
La relation d’aide fait que l’aidant se concentre sur la personne même de l’aidé. Le foyer de l’intervention devient ainsi la personne elle-même et non son problème. Ceci évite à l’aidant la trop forte tentation d’y apporter des solutions immédiates. La relation d'aide peut s'exercer indépendamment de la présence de maladie dûment déclarée. Elle consiste à écouter l'autre dans sa souffrance.
La relation d’aide est à la fois un échange verbal et non verbal pour atteindre un meilleur contact avec sa réalité propre, ses émotions, ses conflits, ses valeurs, ses limites et ses aspirations. Ceci dans une optique de croissance et non uniquement de résolution de problème. En effet la relation d’aide doit apporter un changement, à la suite de ce contact significatif, la personne peut se sentir plus à l’aise, plus courageuse devant l’adversité, plus éclairée sur le comportement à adopter et peut-être aussi un peu plus heureuse.
Pour comprendre les mécanismes de la communication verbale et non verbale, il faut comprendre ce qui se passe dans la communication avec l’autre. La relation d’aide permet de repérer les sentiments de base, elle aide à clarifier et à résoudre les difficultés de la personne qui en a besoin, sans la protéger et sans s’identifier à elle. Elle stimule les ressources de chacun pour développer des capacités d’écoute afin de guider un entretien d’aide.
Cela permet à la personne de voir un peu plus clair dans sa propre situation, de prendre certaines décisions, de trouver le sens réel de sa vie. Cela permet également de se sentir mieux dans sa peau, d’être plus épanoui, plus heureux.
"La condition fondamentale est que l’aidant ait la volonté ferme et profonde de venir en aide à la personne demandant de l’aide. Il faut être persuadé que la personne possède les capacités de pouvoir résoudre son problème par elle-même."
La relation d’aide vise à un plus grand épanouissement de la personne et fonde ses principes sur la confiance en l’homme, c’est à dire que la personne a la possibilité de trouver en elle-même les ressources nécessaires à la solution de ses problèmes.
Cette attitude de se centrer sur la personne permet à l'aidant de faire abstraction de sa subjectivité, de ses sentiments personnels ou encore de sa façon de voir le problème avant que la personne ne le lui ait exprimé qui elle est, quelles sont ses difficultés et surtout comment elle y réagit.
La relation d’aide passe par l’écoute de l’autre et de soi-même. L’écoute non pour comprendre pour soi mais pour que l’autre se connaisse mieux.
Le verbe écouter vient du vieux français escolter et du latin auscultarer, qui veut dire «écouter avec attention»
Rogers la résume ainsi : "La relation d'aide psychologique est une relation dans laquelle la chaleur de l'acceptation et l'absence de toute contrainte de toutes pressions personnelles de la part de l'aidant permet à la personne aidée d'exprimer au maximum ses sentiments, ses attitudes et ses problèmes.
La relation est une relation bien structurée, avec ses limites de temps, de dépendances, d'action agressive qui s'applique particulièrement aux clients, et ses limites de responsabilité et d'affection que le conseiller s'impose à lui-même. Dans cette expérience unique de liberté émotionnelle complète dans un cadre bien défini, le client est libre de reconnaître et de comprendre ses impulsions et ses structures, qu'elles soient positives ou négatives, mieux que dans une autre relation.
Cette relation thérapeutique est distincte de la plupart des relations autoritaires de la vie quotidienne, elle est incompatible avec elles."
Je terminerai par la présentation d’Hetu qui nous permet d'arriver à une définition succincte de la relation d'aide. « Aider quelqu'un, c'est s'engager avec lui dans une séquence d'interactions verbales et non verbales, dans le but de lui faciliter l'expression, la compréhension et la prise en charge de son vécu. Lorsque nous comprenons avec quoi l'aidé est aux prises et quel est son problème, nous devenons davantage capables, à la fois de le respecter dans sa souffrance, et de l'aider à s'en dégager ».
Nous allons maintenant regarder quelles sont les trois conditions qualifiées de nécessaires et suffisantes pour qu’une relation d’aide puisse se mettre en place, pour que soit favorisé le développement de la personne.
Le mot congruence vient du latin «congruo-ere » ce qui signifie «se rencontrer dans un même mouvement » «être en un mouvement concordant » d’où, au sens figuré «concorder », «être en harmonie ».
Etre congruent, nous dit J.M. LABELLE, "c’est donc se mettre en mouvement vers l’autre pour le rejoindre là où lui-même se porte vers moi. Ce qui convient, c’est ce qui vient avec, ce qui correspond à nos routes respectives là où elles se croisent, se rencontrent, se conjoignent, pour un temps limité, dans un espace circonscrit, sans jamais pour autant se confondre. Ainsi, en tant que congruente et réciproque, la relation d’aide permet à chacun d’advenir à soi, sans que l’un s’impose à l’autre, le dépossède de lui-même, le contraigne à devenir autre que lui."
Le Larousse nous donne la définition suivante concernant la chirurgie mais qui, à mon sens, s’adapte également à la relation humaine : Qualité d'une articulation dont les deux parties s'adaptent parfaitement.
L’Encyclopédie Universalis nous apprend qu’en psychologie La congruence est l’accord avec soi-même (coïncidence entre ses besoins, ses désirs, la conscience qu’on en a et l’expression qu’on en donne). Elle incitera le client à déjouer ses mécanismes de défenses pour rétablir sa propre congruence.
A propos de la congruence Carl Rogers nous parle de l’authenticité. "Plus le thérapeute est lui-même dans la relation, n’affichant pas de façade professionnelle ou d’image personnelle, plus grande est la probabilité que le client changera et se développera d’une manière constructive. Il y a un état d’unification, ou congruence, entre l’expérience émotionnelle en cours au niveau des tripes, la conscience de cette expérience et ce qui est exprimé au client."
Dans "le développement de la personne" Carl Rogers s'explique sur l'utilisation de ce mot.
"J'ai employé le mot "congruent" pour désigner ce que je voudrais être. J'entends par ce mot que mon attitude ou le sentiment que j'éprouve, quels qu'ils soient, seraient en accord avec la conscience que j'en ai. Quand tel est le cas, je deviens intégré et unifié, et c'est alors que je puis être ce que je suis au plus profond de moi-même. "
"Pour que la thérapie aboutisse, il semble nécessaire que le thérapeute soit, dans ses rapports, une personne unifiée, intégrée ou congruente. Je veux dire ainsi que, dans la relation thérapeutique, il doit être exactement ce qu'il est et non pas une façade, un rôle ou une prétention. J'ai utilisé le terme de " congruence", pour désigner l'affrontement précis de l'expérience vécue en pleine lucidité. C'est quant le thérapeute est pleinement et correctement conscient de ce dont il vit immédiatement l'expérience dans la relation avec autrui, qu'il est pleinement congruent. Si cette congruence n'est pas présente à un degré important, il est peu probable qu'une connaissance authentique puisse apparaître. "
C’est l’attitude qui permet à l’aidant d’être lui-même et à l’aidé d’être également lui-même. Ce qui fait que chacun est en harmonie avec l’autre, sans pour autant fusionner.
C’est ce concept qui a été pour moi le plus facile à appréhender. Partisan de l’action non-violente j’étais déjà imprégné de ce regard sur l’autre. Gandhi répétait «Aussi dure soit une nature, elle fondra au feu de l’amour, si elle ne fond pas c’est que le feu n’est pas assez fort. » Cette phrase exprime bien ce que signifie le regard positif inconditionnel. Si l’acceptation, l’amour, sans ce qu'il a de possessif, de l’autre n’est pas vrai, réel, fort, nous ne pouvons espérer de changement dans notre relation. Il y a violence dès qu’il y a prise de pouvoir de l’un sur l’autre.
C’est la voie de la non-violence qui passe par l’expression de soi et l’écoute de l’autre. Nous avons là les clefs de la communication non-violente.
L’attention positive inconditionnelle est une attitude d'accueil total, sans à priori ni jugement aucun.
Cela peut paraître simple comme orientation. Mais la mise en pratique est moins facile. Comment puis-je naturellement accueillir avec un regard positif, et surtout inconditionnel, un pédophile ou un fasciste ? Il faut vraiment se centrer sur la personne et non pas sur le symptôme. Il faut voir en face une personne qui a commis des actes. Ces actes on peut les réprouver d'un point de vue moral. Mais si cette personne en face de moi veut en parler cela prouve qu'elle veut avancer vers une compréhension de son problème.
HETU nous apporte une réponse : "L'aidant qui pratique l'acceptation inconditionnelle croit que les humains sont fragiles et imparfaits. Il accepte la condition humaine, avec son lot de toxicomanes, de conjoints violents, de parents inadéquats, de dépressifs profonds et de grandes anxieuses, etc. Mais cet aidant entretient aussi la croyance complémentaire suivante : les humains sont capables d'améliorer leur fonctionnement, pourvu qu'on éprouve envers eux de la compréhension et de la patience et qu'on leur en manifeste suffisamment. "
Pour Mucchielli il s'agit de "respecter le sujet et lui manifester une considération réelle au lieu d'essayer de lui montrer la perspicacité de l'interviewer ou sa domination. Il s'agit d'intervenir de telle façon que nous donnions réellement au sujet la certitude que l’aidant respecte sa manière de voir, de vivre ou de le comprendre, et que nous ne cherchons pas dans son cas une occasion de montrer je ne sais quelle finesse psychologique ou perspicacité qui le mettrait en difficulté. Il ne s'agit pas de faire de la psychologie mais d'écouter et de comprendre."
Pour Anne V. "est aidant, celui qui permettra à l'alcoolique de laisser s'épanouir ses propres potentialités, et d'utiliser ses propres ressources pour trouver, en lui-même et par lui-même, la porte de sortie de son labyrinthe. "
Dans le livre de Kinget et Rogers il est écrit : "L'attitude compréhéhensive s'articule directement sur la pensée de l'écouté sans en modifier la nature ou l'orientation mais en visant uniquement à préciser l'élément vécu, affectif, ou représentatif"
Rogers nous parle d'acceptation ou d'attention, ou de considération ou encore de regard :
"Cela veut dire que lorsque le thérapeute fait l’expérience d'une attitude positive, exempte de jugement, acceptante envers ce que le client est sur le moment, quoi que ce soit, alors un mouvement thérapeutique, ou changement, est plus probable. Cela demande la volonté du thérapeute de laisser le client être le sentiment qu'il est en train de vivre, quel qu'il soit confusion, ressentiment, peur, colère, courage, amour ou orgueil. C'est une attention non possessive. Lorsque le thérapeute accepte le client d'une manière totale plutôt que conditionnelle, un mouvement en avant est probable."
Pour moi l'empathie, c'est la capacité de se sentir en proximité de relation et de compréhension avec l'autre. La compréhension empathique nécessite une vraie présence de l'aidant, pour participer à l'expérience de l'autre. Je compare la compréhension empathique, dans ce qu'elle a d'aidant, à deux engrenages embrayés. L'un ne peut avancer sans l'autre, et l'avance des deux entraîne le tout, "fait tourner la machine"; Les deux personnes sont en "phase".
L'empathie est au coeur de l'écoute comme le défini ARTAUD «l'attitude empathique devient le garant de la prise de responsabilité de l'écouté par rapport à l'explication de son problème, ainsi que de l'extrême respect des personnes. Lorsque quelqu'un se sent perçu et compris, intuitivement, il établit un contact plus étroit avec le champ des expériences qu'il est en train d'éprouver. Il va en retirer des éléments de référence plus importants auxquels il aura recours pour se guider dans la compréhéhension de lui-même et pour assurer son comportement. Si l'empathie s'exerce avec justesse et profondeur, peut-être réussira-t-il à libérer le flux des sentiments éprouvés et à leur laisser libre cours."
Pour l’Encyclopédie Universalis il s’agit de la faculté de s'identifier à autrui, de ressentir les sensations d'un autre. La compréhension empathique : Tout en restant lui-même le thérapeute cherche à se mettre à la place du client, à entrer dans son univers et ses sentiments, en s’efforçant de les voir sous le même angle que lui.
Pour le Larousse c’est la "la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. "
Pour HETU l’empathie "c’est la capacité de saisir le vécu de l'autre en se plaçant dans son univers à lui. Empathie signifiant " sentir de l'intérieur " au contraire de sympathie, qui signifie " sentir avec ". Il distingue deux types d’empathie : l'empathie difficile, dans laquelle l'aidant s'efforce d'accueillir l'aidé dans sa différence, il existe aussi une empathie spontanée. Cette dernière provient du fait que le vécu de l'aidé pour confus ou pénible qu'il soit, rejoint d'une certaine manière le vécu même de l'aidant, du moins son expérience humaine. Le décodage empathique consiste à ressentir le vécu de l'aidé tel que celui-ci vous l'exprime au moment présent, il est fait à ras du sol."
C. Pelligrini la définit ainsi "c’est pouvoir pénétrer dans l'univers de la personne qui me fait face jusqu'à le voir " de l'intérieur ", c'est-à-dire de son point de vue à elle, sans pour autant me fondre dans cette personne "
Pour Anne V, L’empathie c’est "cette faculté de se mettre dans la peau d'autrui, de sentir ce qu'il ressent, de souffrir ce qu'il souffre, mais sans fusion aucune."
Quant à Carl ROGERS. il nous parle de compréhension empathique : "Cela veut dire que le thérapeute sent exactement les sentiments et significations personnelles que le client est en train d’expérimenter et qu'il communique cette compréhension acceptante au client. Quand le fonctionnement est à son meilleur niveau, le thérapeute se trouve tellement immergé dans le monde privé de l'autre, qu'il ou qu'elle peut non seulement clarifier les significations dont le client est conscient mais même ceux se trouvant juste au-dessous du niveau de conscience. Ce type d’écoute, très spéciale, active, est l'une des forces les plus puissantes que je connaisse pour favoriser le changement."
L’empathie est une attitude facilitatrice car c’est l’engagement affectif positif de l’aidant dans une authentification profonde avec l’autre. C’est une sorte d’intuition secrète, par laquelle nous saisirions le sens des conduites d’autrui. S’immerger dans le système de valeur de l’aidé pour en percevoir les messages affectifs. Je sais que je peux sentir ce que tu ressens. L'empathie est cette disposition particulière que j'ai à ressentir le vécu, l'émotion de l'aidé. La compréhension empathique nécessite une véritable présence de l'aidant.
3.2.6. conclusion
Carl ROGERS nous résume la notion clé de cette conception thérapeutique.
"L'être humain a la capacité, latente sinon manifeste, de se comprendre lui-même et de résoudre ses problèmes à suffisance pour la satisfaction et l'efficacité nécessaires au fonctionnement adéquat."
Il ajoute que l'être humain "a une tendance à exercer cette capacité;"
![]()
3.3.1. Définition de l'alcoolisme
Sur son site Internet, Pascal, ancien alcoolodépendant, définit comme suit l'alcoolique :
"L'alcoolique est avant tout une personne, pas un déchet ni un rebut de la société comme on a tendance à le faire croire. Ca peut être n'importe qui, un homme, une femme, ouvrier, PDG, médecin, n'importe qui, mais surtout une personne qui a des gros problèmes avec la boisson. "
Dans le Littré j'ai trouvé la définition suivante, qui peut nous choquer aujourd’hui, mais qui montre bien que même si l’alcoolisme date de plus de 5 000 ans, l’alcoologie est une science toute neuve :
Terme de médecine. Alcoolisme chronique, maladie caractérisée par une détérioration graduelle de la constitution et par des accidents nerveux ; elle s'observe surtout dans les pays froids, où les travaux pénibles exigent l'emploi des boissons alcooliques de la part des ouvriers ; ce qui en conduit beaucoup à abuser de ces boissons.
Lionel Benichou le définit ainsi : "l'alcoolisme n'est ni une question de quantité ni de personnalité ni de produits, c'est lorsque l'usage solitaire de l'alcool prend largement le pas sur l'usage collectif et admis, que le buveur a franchi la frontière. "
Pour Fouquet il s’agit de « la perte de la liberté de s’abstenir d’alcool »
L'alcoolisme est le passage du "bien boire" au "mal boire".
D. Barrucand nous dit que c’est une «interaction entre un individu et un produit, qui se caractérise par des modifications du comportement et l’impulsion à prendre le produit de façon continue ou périodique afin de retrouver ses effets psychiques ou d'éviter les malaises et les privations. »
Quant à l’O.M.S. la définition est : "Les alcooliques sont des buveurs excessifs dont la dépendance à l'égard de l'alcool atteint un degré tel qu'ils présentent des troubles mentaux notables, sur leurs relations avec les autres personnes et sur leur rôle normal social et professionnel, ou qui montrent des prodromes de telles conséquences."
Pour le professeur Simonin "Est alcoolique celui qui absorbe chaque jour une quantité d'alcool supérieure à celle qu'il peut métaboliser sans danger (soit environ 3/4 de l de vin à 10° pour un individu de 70kg)."
Pour les frères PELLOUTIER "L'alcoolisme est propre à notre époque, il est lié à la misère, à l'excès de travail, à la mauvaise qualité des alcools, c'est celui des ouvriers."
Je vous propose de terminer par celle de Coluche car elle rejoint ma préoccupation :
" Un alcoolique, c’est quelqu’un que tu n’aimes pas et qui boit autant que toi ! "
Si ces différentes définitions ne sont pas contradictoires, elles montrent bien les différentes approches de l'alcoolisme et la complexité du problème.
Le terme «alcool » vient de l’arabe «al Kohol » et signifierait «la poudre d’antimoine ». Le sulfure d’antimoine était très utilisé en alchimie et se rapproche de l’arsenic. Le mot lui-même introduit la qualité de son action. Le Köhl, c’est aussi ce maquillage qui rend les yeux brillants.
L’alkohol, le fard, le masque, celui qui trompe.
L’alcool, l'illusionniste, le menteur.
L’alcoolisme désigne avant tout une conduite décrite essentiellement sous forme d’appétence et de dépendance. Divers types et degrés d’alcoolisme sont regroupés dans les classifications de JELLINEK et de FOUQUET.
3.3.2. L'installation dans la dépendance
L'homme peut produire naturellement des endomorphines quand il fait des choses qu’il aime, qu'il se fait plaisir. S'il est frustré ou qu'il n'arrive pas à établir une relation positive avec l’autre, ou s'il n'arrive pas à investir quelque chose qui lui plaise, l’être humain va rechercher les moyens de produire des endomorphines «artificiellement ». C'est ce que peuvent induire les drogues et l'alcool.
Le problème est que l'alcool est une substance licite, omniprésente dans nos sociétés contemporaines, culturellement ancrée dans notre civilisation . Son accès est très facile et la tolérance de 1'entourage est grande par rapport à la dépendance alcoolique.
Ainsi pour produire les endomorphines qui nous sont nécessaires, certains d'entre nous vont investir l'alcool pour se sentir mieux avec les autres et pouvoir entrer en relation avec eux. Cela va marcher pendant un moment puis c'est l’effet inverse qui va se produire. Car sous l'influence de l'alcool, on ne maîtrise plus son comportement, tout le monde s'écarte de l'ivrogne qui parle fort, harangue les autres, sent l’alcool, a des gestes déplacés, "cherche" l'autre etc. ... Ainsi perdant tous ses points de repères, il se replie sur lui-même car il ne sait plus vivre sans alcool, il est obligé de boire pour continuer à produire les endomorphines dont il a besoin.
La première chose à savoir est que l'on ne connaît pas les causes de cette affection et que l'alcool est un produit toxique. La dépendance alcoolique est une maladie universelle. Elle existe dans tous les pays du monde, dans toutes les races, sous tous les climats, dans toutes les professions. Cependant, malgré toutes les recherches présentes et passées, rien n'explique pourquoi certaines personnes peuvent être victimes de l'alcool tandis que d'autres ne rencontrent jamais de difficultés.
On ne connaît personne qui ait décidé d'un seul coup, à un moment donné, de devenir alcoolique.
On n'explique pas pourquoi 90% de la population apprécient ces boissons et n'en deviennent jamais dépendants, alors que chez d'autres la juste consommation est impossible et entraîne l’alcoolodépendance.
L'alcool est un aliment qui se boit. Il empêche, chez la personne alcoolique, l'apparition du signal de satiété et, pire encore, rend le besoin plus intense. Cette réaction, qui n'existe pas chez tout le monde, constitue tout le danger de la maladie puisqu'elle va en sens contraire des lois biologiques, donc de la vie. Elle oblige à ingérer des doses forcément toxiques puisque la régulation naturelle ne vient jamais la limiter, comme c'est le cas pour les autres substances (sauf le chocolat). L'alcool, pour la personne alcoolique, fonctionne à l'envers des autres aliments.
Voici ce qui se passe chez les personnes alcoolodépendantes :
pas d'alcool dans le corps : pas d'envie, pas
de besoin ;
de l'alcool dans le corps : boire encore
n'arrête plus l'envie de boire.
Il s'ensuit une réaction psychologique de recherche de boisson, mais personne, alcoolique ou pas, ne peut arrêter la consommation d'un produit qui augmente lui-même l'appétit de le consommer.
L'alcool ne se nomme pas ! On n'est pas obligé de nommer l'alcool. Quand on dit d'une personne qu'elle boit, il ne s'agit pas de lait ou d'eau, mais d'alcool. De plus les alcools forts ne se nomment-ils pas "eau de vie"!
L’alcoolisme précède la personne alcoolique. Il lui sert de
carte d’identité : je suis alcoolique.
Pour l’ancien alcoolique le passé n’est plus, le futur pas encore et le
présent insaisissable.
L’alcool ils ne s’en débarrasseront pas :
"La séparation reportée sur l’alcool reflète l’impossible séparation, puisque l’alcoolique abstinent ne peut plus boire une goutte d’alcool. C’est la marque de l’évitement même, de la séparation et du manque. Ne plus boire du tout, c’est bien sûr laisser l’alcool omniprésent."
3.3.3. Les effets de l’alcool
"C’est au niveau du système nerveux que les effets de l’alcool sont les plus évidents. La première phase qui suit l’absorption se caractérise par une excitation euphorique. C’est l’effet désinhibiteur de l’alcool. Le buveur se détache des contraintes du monde qui l’entoure. Il voit la vie en rose.
La deuxième phase c’est le système nerveux central qui est atteint. La finesse de jugement, l’attention, la réflexion sont diminuées, la perception du danger s’estompe. La seconde étape atteinte avec des doses plus fortes (0.3-0.5 gr) touche à l’acuité visuelle, la coordination musculaire.
Puis à des doses encore plus fortes c’est la perte de l’équilibre, les troubles de la parole, avant d’atteindre le coma.
Les parties du cerveau sont touchées de plus en plus profondément.".
3.3.4. Alcoolisme et angoisse
L’angoisse est souvent la cause des alcoolisations. Henri LABORIT nous rappelle que l’angoisse survient lorsque l’on ne peut agir, c’est à dire ni fuir, ni lutter. Alors l’homme a imaginé des trucs pour occulter cette angoisse. D’abord, ne pas y penser, et pour cela agir, faire n’importe quoi, mais quelque chose.
Boire pour oublier, c’est faire quelque chose !
Pour illustrer ce phénomène les cliniques du C.A.L.M.E. utilisent l'histoire d'un petit chevreuil.
Dès son invention l’alcool est repéré comme remède à l’angoisse, la souffrance, la douleur. « Bacchus est un dieu bon, en faisant divaguer la raison, il empêche l’ankylose de la logique et prépare l’invention relationnelle. »
L’alcoolique cherche à évacuer son angoisse dans l’alcool et pour lui, l’arrêt d’alcool c’est la castration.
Le principal travail que nous ayons à faire est de libérer le malade alcoolique de son angoisse. Si nous ne favorisons pas chez lui cette libération émotionnelle, il va "marcher à l'envers" et absorber de l'alcool pour se libérer de cette angoisse.
Suivant l’angoisse la consommation sera occasionnelle ou continuelle. Il est difficile de trouver une explication à l’angoisse. En effet l’alcoolisme représente un passage à l’acte permanent qui ne s’accompagne pas de parole.
ROGERS nous précise "que les effets de la peur peuvent se comparer à une épine dans le pied ; ceux de l’angoisse à une infection. L’une peut être extirpée tandis que l’autre requiert un certain assainissement général."
3.3.5. Pourquoi est-il si difficile de parler de son alcoolisme ?
Parce qu’il cache un symptôme né avant l’apparition du langage et donc pas verbalisable ?
Mais au regard de mon expérience, l’explication qui m’a le plus accroché, je l’ai trouvée sur le site internet de Martine MORENON. Je vous livre les passages relatifs à "alcool et langage" :
l'alcool empêche de parler L'alcool empêche de parler. Ce phénomène est, en vérité, indépendant de l'alcoolisation. Il existe dans toutes les circonstances où l'humain se voit contraint d'obéir à son corps. Il faut remarquer que nous sommes ainsi fait que nous parlons "à l'endroit" quand notre corps nous obéit, mais "à l'envers", ou pas du tout, quand, à l'inverse, nous devons lui obéir. Dans le travail, les loisirs, les sports, l'esprit commande et le corps exécute. Dans un match de tennis, par exemple, l'esprit dirige, même si le corps est très actif. Tout se montre et se raconte. Par contre il est des circonstances où le corps commande et l'esprit se soumet. Aller au "petit coin", par exemple. Mais il en est de même d'activités plus nobles, comme l'amour : dans la sexualité, pour que tout fonctionne bien, l'esprit doit se laisser guider par le corps aussi parfaitement que possible. Ces choses ne se racontent pas, et ne doivent pas se raconter ni s'entendre. Un sentiment que tout le monde ressent, appelé pudeur, reflète un phénomène linguistique qui, dans l'obéissance au corps, arrête la parole et oblige quiconque à mentir, se taire ou se révolter devant un dévoilement indiscret. On l'aura compris, l'alcoolique est réduit au silence et au mensonge. Il l'est comme toute personne rendue pudique par la soumission à un acte corporel. Nous sommes loin de la prétendue "mauvaise foi". Il faut comprendre aussi que, sommé d'avouer, l'alcoolique se dérobe ou se révolte, comme chacun peut le faire quand sa pudeur est offensée. Cela lui arrive souvent et ne nous étonnons pas qu'il devienne, comme on l'a dit, un "artiste du mensonge". A moins qu'il ne se défende en jouant le mauvais caractère. Lorsque l’obéissance au corps est requise, dans la vie sexuelle comme dans l’alcoolisme, c’est le silence et le secret de l’acte qui s’imposent, un secret particulier et que chacun connaît, et qui chez l’alcoolique est contenu dans cette phrase : « je sais que vous savez ». Mais au risque de la honte, cela ne peut se dire ou se laisser voir. De plus en plus, vis à vis de l'alcool, il se voit condamné à obéir à son corps, obéissance qui le contraint au mutisme, ou à son équivalent, l'intolérance verbale, et dans tous les cas au mensonge. Il se trouve que le besoin de l'alcoolique n'est pas moins continu et impérieux que le besoin d'air de tout le monde. Voilà ce qui va changer sa vie parce que tous les autres temps, du travail, des enfants, du repos ou de l'amour, se trouvent bousculés et tous subordonnés à la priorité de l'approvisionnement en alcool. |
Les psychanalystes avancent que : "L’alcool tient lieu de cause, tient lieu de souffrance, et parfois de pensée.
On peut se demander si finalement le buveur n’est pas bu autant qu’il boit, il est comme aspiré. Ne pas supporter un verre vide, c’est déjà rappeler que le vide est au cœur. L’alcoolique fait l’épreuve du vide, par alcool interposé. L’alcool serait tenant lieu du vide. Boire comme un trou.
Se trouver réduit à être un trou, ni plus ni moins qu’un trou qui aspire. L’angoisse précisément est liée au trou, à ce qui fait trou, à ce qui ne peut se représenter."
TARDE considère le café comme objet psychosocial. Il a réalisé une étude sur la "conversation" dans les cafés, lieu d'apprentissage en général : "Les modalités du boire". Ainsi chez les clochards, la ritualisation domine tous les échanges et qu'il s'agisse du tour de parole ou du tour de bouteille, c'est la compétence de communication, les rites régulateurs qui y sont requis, ce que je retrouve dans le fonctionnement des groupes de parole.
"On notera que l'absence de relation est particulièrement nette, lorsque l'alcoolique privilégie la seule compagnie de son verre… et que la répétition du geste signale une régression à la forme la plus primitive qui soit de l'imitation : l'imitation de soi, c'est à dire d'avant la copie."
3.3.6. Du déni et de l'aveu.
Toute personne en contact avec des malades de l'alcool se trouve confrontée avec le déni. Déni sur la consommation, sur la quantité, sur l'acte même. Le travail de tout intervenant en alcoologie doit être de pas tomber dans l'aveu. Le déni implique un acte volontaire, décidé par le sujet. Or ce n'est pas toujours le cas en cas d'alcoolisation. Combien de fois ai-je entendu des personnes, en proie au désespoir, qui se demandaient sincèrement pourquoi elles avaient consommé. "Qu'est ce qui m'est arrivé ?" "je ne comprend pas, quand je suis sortie, je t'assure, j'avais pas envie de boire. " Certains sujets pour se persuader qu'ils maîtrisent tous leurs actes en deviennent agressifs. " Eh oui j'ai picolé, et je t'emmerde !"
En restant dans le système déni/aveu nous omettons la personne et nous réduisons l'alcoolisme à un comportement et le comportement à un symptôme. Nous interrogeons la culpabilité du sujet et non sa responsabilité, ce qui bloque tout processus exploratoire. L'alcoolisation est de leur fait et non de leur faute.
Anne V. nous parle de son déni :
"Les psychanalystes ont trouvé
toutes sortes d'explication, parfois extravagantes, à ce refus du réel qui chez moi, de
toute évidence, provenait de la honte et de l'impossibilité d'avouer l'inavouable.
Mécanisme de défense, disent certains alcoologues, le déni permettrait d'échapper à
la dépression, à l'effondrement complet qui serait de se reconnaître alcooliques,
c'est-à-dire taré et vicieux à ses propres yeux comme aux yeux d'autrui. Je ne serais
pas surprise qu'ils aient raison : lorsque je m'obstinais à nier ce qui sautait aux yeux,
je sentais bien que l'enjeu était de taille, et allait bien au-delà du mécontentement,
ou même de la fureur de celui que j'essaie d'abuser."
3.3.7. L'abstinence
Pour l'alcoolique qui n'a pas encore assimilé le fait qu'il soit atteint d'une maladie dont il n'est pas responsable, l'abstinence est ressentie comme la punition terrible de ses fautes et de ses pêchés.
C'était le cas avant guerre avec les mouvements d'anciens buveurs créés par les prêtres, les pasteurs, avec la bénédiction de certains psychiatres. L'ivrogne se rend coupable du pêché d'ivrognerie, la religion va lui permettre d'amender sa conduite, il deviendra un "alcoolique repenti". Il pourra légitimement trouver la punition trop dure ou injuste et reboire le jour où il pensera avoir été assez puni.
Pour gagner le Paradis il faut remplacer l'Enfer de l'alcool par l'Enfer de l'abstinence.
J'ai l'impression que trop souvent l'abstinence est présentée comme le but à atteindre. Ce n'est qu'un moyen pour arriver à une vie plus satisfaisante. C'est une nécessité absolue pour les alcoolodépendants.
"Il semblerait que le souci de tous soit, doive ou puisse n'être que de ménager sa monture alors que c'est à l'éprouver qu'on prend généralement du plaisir"
![]()
4. ANALYSE DE MA PRATIQUE de l'approche centrée sur la personne
Nous allons essayer de comprendre comment l’approche centrée sur la personne m'a permis une meilleure écoute des alcoolodépendants. Je vais essayer de vous faire partager les changements que j’ai observés, chez l’aidé, et chez moi-même quand j’ai orienté mon travail en le centrant sur la personne.
4.1. Idées générales
J'ai l'impression que, par le travail d'écoute, je leur propose de faire travailler leur corps à l'envers. Leur bouche qui était la porte d'entrée du plaisir fonctionnait de l'extérieur vers l'intérieur, en absorbant l'alcool. Et ça a fonctionné parfaitement pendant plusieurs années. Je cherche à leur procurer du plaisir en faisant fonctionner le corps de l'intérieur vers l'extérieur, en se libérant de leur angoisse par la parole.
C'est une des raisons pour lesquelles ce travail d'écoute en face à face se trouve confronté à des résistances.
Je pense que le fait de parler de son problème alcool est le début de l’entrée dans une période de vie plus sereine pour l’alcoolodépendant, car cela diminue la honte et l'angoisse.
"L'alcoolisme est une maladie de la communication, c'est une maladie qui se soigne par la communication aussi. Si tout le monde reste muet, personne ne va guérir." Face à une personne qui ne souhaite pas parler, il va falloir que je lui fasse l'avance des mots en l'aidant à explorer ses sentiments.
4.2. Premières constatations
Dans les premiers entretiens que je réalisais, je me suis aperçu qu’après un quart d’heure d’écoute, j’avais déjà choisi, parmi tout ce que l’autre venait de me dire, le sujet vers lequel j’allais l’entraîner. Et nous allions approfondir ce qui me paraissait important pour lui.
J’avais l’impression que j’étais obligé de diriger l’entretien car les clients sautaient facilement du "coq à l’âne" et que l’essentiel ne passerait pas. Il fallait que je leur "tire les vers du nez"
Les changements que j’observe en ayant une autre façon de communiquer leur permet de s'exprimer. Si je n’interviens pas mais que je me contente de reformuler ou de hocher la tête, ils continuent de parler. Je ne pensais pas qu’une personne pouvait parler d’elle pendant trois quarts d’heure sans me poser de questions, sans que j’intervienne. Certains me disent, "On a bien discuté aujourd’hui."
Maintenant je sais que c'est par ma présence et mon attitude que ces personnes peuvent s'exprimer, et je me sens donc utile. Auparavant si je n'intervenais pas, j'avais l'impression que je ne servais à rien et qu'il fallait absolument qu'elles m'écoutent et suivent mes conseils. C'était vraiment la seule voie pour qu'elles puissent s'en sortir.
Lors d'une visite chez Sylvie, elle me parle de ses enfants qui sont terribles en ce moment, de son logement et d'un stage qu'elle voudrait bien trouver. Quand je décide de "commencer", je lui dis : " Tu me parlais de tes enfants qui sont terribles en ce moment ?" "Oh ! Oui c'est surtout Damien et avec sa sœur ils se battent tout le temps." Et Sylvie me parle de ses enfants.
J'avais le sentiment que si je choisissais une de ses préoccupations, je lui permettais une meilleure expression. Je me suis rendu compte que non. J’avais l’impression qu’ils n’étaient pas capables seuls, de trouver la voie. Il fallait donc que je les aide, que je leur montre le chemin.
Le changement d’attitude s'est bien déroulé. Je laisse la personne mener l’entretien. Je l’accompagne. Je la laisse aller, même si je sens de quoi elle veut parler, elle arrive toujours à aller à l’essentiel de ce qui la préoccupe, même si son exploration passe par différents méandres. De plus si elle se sent interrogé, elle se met vite en retrait.
HETU écrit : "Le rôle de l'aidant n'est pas de contrôler tout ce qui se passe dans l'entrevue, mais simplement d'intervenir de temps à autre pour stimuler l'exploration de son aidé."
Je sens que si Michel veut sortir de l'alcool, il doit régler le problème que lui posent les femmes et sans doute sa relation avec la toute première femme, sa mère. Maintenant je sais qu'il ne faut pas que je le brusque, je ne dois pas l'orienter. Je dois être présent auprès de lui. Au fur et à mesure de nos entretiens le sujet des relations avec les femmes est abordé de plus en plus souvent et plus émotionnellement; les larmes viennent. Je le laisse aller à son propre rythme.
Il y a souvent des moments de silence très angoissants pour lui, (mais moi je ne me sens plus porteur de ses angoisses) il pleure souvent pendant ses temps de silence et me répète que je n'ai pas à m'inquiéter ou qu'il me trouve songeur. Je lui réponds simplement que je l'écoute.
Maintenant j’accueille la personne et la laisse plus libre de parler et de «conduire » l’entretien comme elle le sent.
MUCHIELLI explique cette différence : "Accueil et non pas initiative, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une attitude de réceptivité d'accueil, au sens ou l'on reçoit un invité chez soi. Où l'on sait l'inviter à entrer et à se défaire de son manteau protecteur. Où on l'invite à entrer davantage et à se mettre à l'aise. Ceci s'oppose à une attitude d'initiative qui met le client dans l'obligation de répondre aux questions et de réagir."
Je remarque qu'il est important de suivre la pensée de l'autre, de penser "avec lui" mais pas à sa place, pas "pour lui" ce qui est proche dans la démarche d'aide vers l'autre que souhaite chaque éducateur, mais ce qui est fondamentalement différent. La reformulation permet de savoir si je suis toujours en phase avec lui, ou si je suis dans le "il faudrait que…. Ça serait bien pour lui".
4.3. L'exploration des sentiments
La manifestation des sentiments et leur acceptation par l'aidant permet une libération émotionnelle bénéfique pour l'aidé. Nommer les sentiments me paraissait un peu ridicule.
Dire à Jean-Claude que j'ai le sentiment qu'il est en colère alors que lui, hurle, gesticule dans tous les sens, peut paraître une absurdité. Mais ça l'apaise, il confirme comme si le fait de mettre un mot sur un sentiment était magique. Il me répond "C'est normal, non, y'a de quoi." Et il s'assied.
Nommer le sentiment que l'on ressent chez l'autre permet que l'exploration de ce que l'aidé est en train de vivre se poursuive. Quand je dis à Thérèse que je la sens triste, cela lui permet d'accepter son sentiment "Ben oui, c'est pas facile." Et de lâcher prise en laissant les larmes, qu'elle retenait, couler. C'est une sorte d'autorisation de vivre les sentiments sans gêne.
4.4. La congruence
Quand il y a rencontre entre deux personnes, tout, le regard, la parole, l'attitude, les gestes, suggère immédiatement chez l'autre une réaction.
Quand Christine vient me voir parce qu'elle est préoccupée, elle m'imagine être disponible. Or ce jour là, je n'étais pas prêt à la recevoir ! Pas prêt parce que je ne l'attendais pas et pas prêt car la journée avait été rude. Elle s'en aperçoit et me dit d'un ton agacé "J'ai l'impression que c'est pas le moment, mais moi aussi j'en ai marre, je vais tout plaquer" ma non-disponibilité a favorisé la montée en puissance de son angoisse. Je suis persuadé que si je l'avais accueillie, c'est à dire si j'avais été ouvert, sa réaction aurait été différente. Si je l'avais accueillie avec le sourire si elle m'avait senti disponible, j'aurais sans doute, vu son état intérieur, déclenché une émotion agréable, et du coup son angoisse aurait commencé à baisser. Je n'ai pas eu une attitude sécurisante pour elle ce soir là.
L'harmonie entre le langage verbal et le non verbal, la cohérence entre ce que je dis et ce que je pense est importante. Quand Fernand, que je ne connais pas, me montre son volumineux dossier judiciaire, je veux avoir une parole rassurante, alors que je pense que son avenir est sombre, mais ne veux pas lui dire (pourquoi ?). "Nous allons regarder ensemble, ça peut s'arranger" sa réplique est immédiate "Te fous pas de ma gueule ! je vois bien que c'est foutu, t'as vu la tête que tu fais en lisant."
4.5. L'empathie
Je ressens bien cette compréhension lors de certains entretiens où nous nous comprenons et l'aidé avance dans l'exploration de ses sentiments. Je perçois bien ce que l'autre me dit. Je sens que nous cheminons ensemble et que l'aidé y trouve son compte, dans le sens où il prend ce qui est proposé dans la rencontre. Cela lui permet d'avancer sur la voie de la guérison. Je me dis, dans ces moments là que je suis dans le "vrai". C'est ce que j'appelle "un bon entretien"
Nathalie, qui me connaît pourtant depuis plusieurs années, me demande si je ne suis pas un ancien alcoolo ? Est-ce que mon empathie irait jusque là ?
4.6. La présence
La constatation globale de la mise en pratique de l’approche centrée sur la personne est qu’effectivement la demande principale de l'aidé est de trouver en face de lui une personne qui soit présente. Une personne qui, dans un temps donné, ne consacre son temps qu’à l’autre. Même si la demande est exprimée uniquement avec une demande matérielle.
L’autre se sent accueilli si on se centre sur lui, si on accueille l'expression de ses sentiments, même si on ne répond pas positivement à sa demande. Si je me centre sur sa demande, lui aussi se centre sur sa demande et nous focalisons là-dessus.
Prenons l’exemple le plus fort : une demande d’argent. Si la décision est de ne pas répondre favorablement à cette demande, plusieurs attitudes sont possibles. Soit je me centre sur le problème, c’est à dire sur la demande d’argent et son refus, et nous entrons de part et d’autre dans des explications, des justifications qui perturbent la relation.
Soit je me centre sur ma propre personne : comment je vais lui présenter mon refus, ou même sur ma culpabilité "Pascal, tu exagères de refuser ce secours, pour toi c’est facile tu gagnes 5 fois plus que lui, etc."
Une autre solution consiste à évacuer le problème Il n'avait qu’à pas aller les boire !" Quelques fois ces attitudes peuvent même être combinées ensemble dans un même entretien.
La solution de se centrer sur la personne, permet que la rencontre ait lieu. C’est à dire que la fausse culpabilité de l’aidant soit mise de côté. Nous pouvons échanger. Je suis centré sur la personne de l’aidé, ses difficultés par rapport au manque d'argent, sa souffrance, sa culpabilité ses sentiments.
Quand Alain vient me voir pour obtenir une avance de 100f, "pour faire manger sa fille", je sais bien d'une part, que cela ne va pas régler le problème et d'autre part si je rentre dans ce processus je ne pourrai plus agir autrement. Malgré la grande colère d'Alain, je reste calme et interroge son ressenti, son excitation, son énervement. Mon bureau s'envole et mon refus persiste. Au bout d'un moment, il se calme et interroge mon calme, qui dit-il "le rend nerveux", alors que j'observe le contraire. Je pense que j'ai "gagné" ce jour là car je suis resté présent près de lui et me suis intéressé à lui en tant que personne.
GENDLIN écrit à ce propos : "l’essence du travail thérapeutique avec une autre personne consiste à être une personne vivante et présente."
Salomé ajoute simplement "Ecouter, c'est déjà aider"
4.7. L'effet libérateur
Une autre découverte dans la mise en place de l'approche centrée sur la personne est le constat du changement d’attitude de l’aidé au cours de l’entretien. Souvent en début d’entretien, la personne a une appréhension, soit de vouloir aborder sa difficulté, soit de ma réaction face à un évènement ou d’être obligé de me rencontrer. Je me suis aperçu que si je me centre sur la personne, sur le vécu de ses émotions, si je suis présent là, dans l’ici et maintenant et bien cette tension tombe progressivement.
J'ai observé cette baisse de tension surtout avec les entretiens enregistrés. Sans enregistrement il est difficile de s'en apercevoir.
Joseph est ce qu’on pourrait appeler un ancien alcoolique, dans le sens où son dernier verre remonte à plusieurs années. Mais l’alcool reste présent car il a profondément marqué son comportement. Quand je le rencontre, il est souvent angoissé par des tas de choses plus ou moins réelles.
Lors d’un entretien à son domicile, Joseph me dit entendre des voix ; il me montre la fenêtre de la tête, il remue beaucoup, se balance, est tout rouge. Je lui dis que, moi, je n'entends pas les voix, mais qu'il peut me parler de ses voix de ce qu'elles disent. Il me raconte qu'il s'agit d'un monsieur qui crie après une dame. Puis de son père qui criait beaucoup. Plus il me parle plus il se calme.
Joseph parle longuement de son travail chez son père, de la situation familiale, il ne me reste plus qu'à écouter attentivement. Il est redressé, je le sens beaucoup plus détendu, il évoque des souvenirs heureux, quand il était scout, il a le sourire.
Le fait d’être centré sur la personne de Joseph et non sur son symptôme a des effets positifs sur le moment présent.
Il est parfaitement conscient de son mieux être et le verbalise en me disant soulagé que "ça va mieux, il faut que je revienne te voir."
Robert a l'impression, depuis longtemps déjà, qu'il est poursuivi par une personne qui lui veut du mal. Au début de l'entretien il est très nerveux, a du mal à respirer, regarde toujours par la porte-fenêtre. Il me parle de ce qu'il ressent. Plus l'entretien avance plus je sens la tension baisser. Robert s'apaise, il se sent comme libéré. Il le ressent également et l'exprime : "Ouf ! ça va mieux, j'étais pas bien en arrivant"
4.8. les silences
Deux choses sur le silence. Celui pendant les entretiens et le rôle du Silence dans l'histoire des personnes :
4.8.1. Pendant les entretiens
Au début, je ne savais pas me taire. Je laissais très peu le silence s’installer. J’avais l’impression que l’autre attendait une réponse de ma part, des conseils et les temps de silence étaient angoissants pour moi. Parler calmait mon propre malaise. Maintenant le silence permet à l'autre de cheminer dans sa pensée. Je l'accompagne par mon silence. Je peux l'interroger au bout d'un temps sur ce qu'il ressent. Le silence donne plus de sens à la communication non verbale.
Pour les premiers entretiens, pour l'entretien d'accueil, les temps de silence doivent être plus courts. J'ai l'impression qu'ils favorisent l'angoisse de l'aidé.
4.8.2. Dans la vie
Pour des personnes qui ont été très abîmées, ignorance, maltraitance, amour étouffant, drame sexuel, violence de toutes sortes, on a étouffé la parole. "Tu n'as pas intérêt à en parler, sinon gare à toi !" Le silence était la règle. Pierre m'a parlé une fois de relation "pas normale" qu'il subissait dans sa famille. Il me parle plus souvent d'une grande admiration pour son père qui faisait plein de choses pour lui. Quand il a pu aborder les sévices sexuels avec son père, il était très mal. L'alcool a repris une place importante dans sa vie. Il a très vite quitté la région où il a rompu la règle du silence.
Yves lors de certain entretien me dit "tu sais des fois je suis fou" ou "dans ma tête y'a des trucs qui ne tournent pas rond" j'ai essayé de l'aider à explorer ce qu'il me disait, mais rien. Et comme moi aussi, j'ai parfois l'impression que ça ne tourne pas bien dans ma tête, je ne me suis pas trop inquiété. Un jour Yves se présente au bureau avec son sac de voyage et une convocation de la police "pour affaire vous concernant". Il demande à ma collègue de l'accompagner car "ils vont me garder, j'en suis sûr". Yves a été condamné à une peine de 30 ans pour pédophilie. Il est parti avec son secret.
Cette règle du silence, je dirais cette chape de plomb, n'existe pas que dans le cercle familial.
Dans l'armée également pour les plus anciens, pendant la guerre d'Algérie : Bernard était perçu comme un homme très calme la journée mais la nuit il ne dormait pas. Il a mis beaucoup de temps, et a utilisé de grandes quantités d'alcool avant de pouvoir dire que toutes les nuits il entendait hurler les "fellagas" sous la "gégène" qu'on lui demandait de faire fonctionner.
Dans des conflits plus récents au Tchad : Régis a participé à des opérations de "nettoyage" où "des enfants ont trouvé la mort". Ces images hantent véritablement ses nuits. Et de tout ça il ne fallait pas parler, c'étaient des actions importantes pour le pays. Régis est encore plus dans la trahison que dans la libération.
S'ils avaient pu en parler plutôt, leurs vies en auraient été modifiées.
4.9. Ecouter pour entendre
Le fait de laisser la personne dans son expression et ne de pas orienter ou interpréter m'a permis de me rendre compte de l'importance de l'écoute de l’autre.
Lors de son premier groupe de parole, Robert, après la lecture du protocole où il est dit : nous sommes là pour évoquer des situations que l’on vit en étant au service de suite, demande si c'est différent entre le service hébergement et le service de suite. J’aurais très bien pu lui expliquer les différences. Mais je lui demande ce qu’il répondrait si on lui posait cette question ? Il se lance alors dans le récit des difficultés qu'il éprouve actuellement depuis qu’il a quitté le foyer et qu’il se retrouve seul dans son appartement. De la peur de ne pas pouvoir y arriver, etc.… Si j'avais répondu à sa question, son expression s'en serait trouvée annulée. C’est l'approche centrée sur la personne qui m’a permis d’agir ainsi, d’interpeller son ressenti. Et non de vouloir répondre directement à la question, centrée sur le problème.
Au cours d'un entretien, Charles me parle d'une rencontre avec des collègues où il lui a été dit qu'on n'arrivait pas à le saisir. Il me demande ce que nous entendons par "saisir". Je connais cette expression quand nous n'arrivons pas à comprendre une personne, je peux lui expliquer, mais ce jour là, la formation aidant, je lui demande ce que lui entend à travers ce mot, ce qu'il représente pour lui. Il me parle d'un homme, alors qu’il avait cinq ans, qui est venu le saisir chez sa famille d'accueil en lui disant" je suis ton père et tu vas venir vivre avec moi et ta mère". Il me raconte cette période de sa vie, importante pour lui, aujourd'hui. Si j'avais répondu directement à sa question, je n'aurais pas favorisé cette expression personnelle.
4.10. La résistance
Parfois (trop souvent ! ?) dans mes contacts avec les alcoolodépendants j’ai le sentiment «qu’ils n’ont pas envie de s’en sortir ». Comme si la situation de galère qu’ils vivent actuellement leur apportait plus de bénéfice qu’un éventuel changement qu’ils ont tant appelé de leurs vœux !
Je rencontre souvent une sorte de résistance à la guérison, résistance non consciente et comme défensive, qui prouve que la dépendance est constituée d'une fuite devant la réalité à affronter et qu'elle est, pour ainsi dire, un refuge, certains parlent de bulle dans laquelle ils s'enferment.
Christian est absent aux rencontres prévues, il ne prévient pas, ne répond pas à mes messages sur son répondeur, à mes mots dans sa boîte aux lettres. Et un jour il réapparaît "frais comme un gardon". Lors de l'entretien que nous avons, il me parle de la "bulle hermétique" dans laquelle il s'enferme. Il n'en sort que pour s'approvisionner en alcool et rien autour de lui n'a d'importance. Il fait le mort.
Albert ne sait pas venir sans être dans une plainte. Une rancœur envers les autres. A chaque fois il y a quelque chose qui va mal. J'ai eu plusieurs entretiens avec lui et n'ai pas réussi à débloquer la situation.
Jacques SALOME m’apporte une explication quand il dit : "Il souhaite parfois être reconnu comme étant malade, malheureux, en difficulté, et maintenir à tout prix cette position. L’investissement érotique de la plainte, de la souffrance, conduit l’aidé à trouver plus de plaisir à se plaindre qu’à être vraiment entendu. Il construit un système relationnel qui lui permet d’entretenir sa place de victime tout en accusant l’autre, le monde entier, et il en attend la confirmation…de vous !"
Or il faut du temps pour que l’aidé, si l’aidant est suffisamment à l’écoute, puisse dépasser ce stade.
"Il n'y a pas de cas désespérés", dit en écho le docteur VACHONFRANCE, "il n'y a que des cas désespérants."
Habib me parle de son amie à qui il n'a pas dit son histoire avec l'alcool, il veut se donner une autre image de lui face à elle. Quand il aborde ce thème, ça ne dure que très peu de temps. Il prend la fuite. Il prétexte qu'il avait oublié un rendez-vous, qu'il était juste passé me dire un petit bonjour. Son angoisse est telle qu'il ne peut affronter cette question.
"A un moment donné de la psychothérapie, il sera nécessaire d'analyser la nature de ce refus et de tirer au clair l'image fantasmatique de la guérison devant laquelle le malade recule affolé."
Je sens bien que dans certains entretiens il existe des résistances. HETU nous rappelle que La résistance c'est : " les moyens que nous prenons pour ne pas entrer en contact avec ce qui nous dérange."
4.11. La souffrance
Il m’a été difficile de ne pas prendre en charge la souffrance de l’autre, de ne pas pouvoir le soulager, là, tout de suite. Mais je me suis rendu compte qu’on ne peut pas faire l’économie de la souffrance chez le patient alcoolodépendant. On peut seulement l’encadrer, l’accompagner. L’aider à mettre des mots sur cette souffrance, mettre des mots sur les maux. On peut lui permettre d’être à l’écoute de sa blessure, de ce qui est touché en lui.
La souffrance d'autrui ne doit pas être vécue comme une brique qui vous tombe dessus, mais comme une bûche qui fait flamber plus haut et plus clair le feu de la compassion.
Proverbe tibétain
Le fait d'avoir réglé, du moins en partie, ma difficulté avec la souffrance de l'autre me permet d'être plus aidant.
J'ai bien senti qu'avec Maurice qui se présentait toujours comme un pauvre malheureux, j'ai fait beaucoup de choses matérielles dans le but de diminuer sa souffrance. Ce faisant, je fermais la porte à l'exploration de ses sentiments. J'ai le sentiment qu'elle m'atteint moins et que je peux plus facilement lui venir en aide.
Je me sens comme plus "détaché" de la souffrance de l'autre.
4.12. Besoin de l'autre
Les changements observés pendant ma formation tiennent également peut être en partie, à un changement de demande. Au départ je suis là pour eux, car c'est supposé qu'ils ont besoin de moi. Et là, changement, j’avais besoin d’eux. Besoin d'eux pour analyser mes entretiens.
Mes déplacements avec mon magnétophone, mes absences pour formation, les échanges que nous avons pu avoir sur son contenu, montraient, peut-être aussi, que j'avais envie d'être plus aidant.
Dans des entretiens centrés sur la personne nous sommes plus à l’écoute de la personne, afin qu’elle perçoive mieux ce qui se passe en elle, nous avons, en un sens, besoin d’elle, pour l’aider. Comprendre, pour moi, ce qui est intervenu dans une rechute, m'intéresse, donc l'autre se sent utile dans l'apport de connaissance qu'il me permet. Sa vie à de l'importance pour moi. Et du même coup, il s'entend parler.
"Accompagner, ce n'est pas se substituer, remplacer ou diriger, c'est agrandir en échos les possibles de l'autre en cheminant au plus près de lui, mais en étant différent de lui."
Anne V. nous dit : "Pour être en mesure d'aider véritablement un autre alcoolique, il faut avoir besoin de lui autant qu'il a besoin de vous. Personne apparemment n'y avait pensé avant Bill (fondateur des Alcooliques Anonymes) " c'était quelque chose de complètement réciproque ".
4.13. L'alcool.
Le constat le plus important concerne ce qu’on appelle «les alcoolisations ». Le rapport à l’alcool. Si mon action est centrée sur la guérison du symptôme, si mon désir est que la personne arrête de boire, parce que tout le monde sait bien que pour quitter l’alcoolodépendance, il faut entrer en abstinence. Tout le monde le sait sauf l'intéressé et même s’il le sait, il ne peut pas en parler, comme nous l’avons vu au chapitre précédent.
Quand une personne arrivait dans mon bureau en sentant l’alcool, j’étais centré sur l’alcool, sur la façon dont allait se dérouler l’entretien, sur le déni, qu’immanquablement il y allait avoir, et sur toute l’énergie, que je devrais déployer pour arriver à l’aveu. Et j’avais le sentiment que, d’avoir fait en sorte qu’il reconnaisse son alcoolisation, je pensais que ça pouvait l’aider. Je me demande maintenant, si dans ces cas là, l’alcoolisation n’était pas plus mon problème que le sien.
En utilisant l’approche centrée sur la personne je me suis aperçu que l’autre se sent reconnu comme une personne, avec une histoire, une vie, et pas seulement comme un ivrogne.
Maintenant je ne suis plus, depuis un moment déjà, dans le schéma classique Déni/Aveu et les entretiens sont plus constructifs. Il s'agit simplement d’une rencontre entre deux personnes, dont l’une est là pour aider l’autre. C’est un grand progrès dans la démarche
En parlant de l’alcool «tu as consommé », «tu sens l’alcool » on utilise le tu qui tue et on bloque la communication. Ce n'est pas la même chose si je dis que je sens l'alcool, il n'y a pas accusation de l'autre qui va nier, mais expression de mon ressenti.
N'oublions pas que c'est en nommant le détail qu'il devient obscène : ainsi en est-il de la simple question "combien buvez-vous ?" Qu'il faut soigneusement éviter !
Quand un homme parle de son alcoolisation, il attend comme une punition, une sanction de ma part.
Faire percevoir que l’alcoolisation est de son fait et non de sa faute me paraît important. Quand j'interroge les faits, et non la faute, le dialogue est possible. Lors d'une consommation d'alcool interroger les lieux, les temps de consommations, les heures, est possible, car on s'adresse à des faits.
Eric, ne parle pas de ses alcoolisations. Quand je l'ai aidé à interroger les faits, il cherchait avec moi les circonstances de ses consommations. Toujours dans des lieux publics, avec d'autres. Eric a pu remarquer qu'il n'a de relation "vraie", qu'il a l'impression de rencontrer "des vrais copains", d'avoir quelque chose à partager avec les autres, que sous l'emprise de l'alcool. "Avec toi, je peux discuter sérieusement à jeun, avec les autres je ne peux pas, quand je suis plein, c'est pas pareil, là ça va mieux, j'sais pas pourquoi, mais c'est comme ça !"
4.14. Le groupe
Globalement le fait que j'aie orienté mon approche des alcoolodépendants en la centrant sur la personne a eu un impact sur le groupe de personnes que j'ai d'accompagnées. Elles me parlent plus facilement de leurs alcoolisations, de leur rapport à l'alcool.
Les alcoolisations sont moins cachées car la personne se sent reconnue même si elle s'alcoolise.
A une période j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de personnes qui s'alcoolisaient. En fait c'était surtout dû au fait qu'elles en parlaient, alors qu'avant mon attitude faisait en sorte qu'elles avaient plus tendance à le cacher.
Isabelle Sokolow donne peut-être la position que doit avoir l’aidant face aux malades de l’alcool : "Je dis toujours, les patients, c'est pas eux, c'est nous. On doit être comme des piquets, là. Des piquets d'ancrage dans un port, et l'on attend que le bateau daigne bien s'arrêter. Et alors notre rôle c'est d'attendre, et d'être disponibles quand ils le veulent. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, ils approchent."
4.15. Divers
Si l'aidé sent que l'on s'intéresse à lui, c'est un élément qui favorise la relation. Car il a le sentiment d'être rejeté de partout soit à cause de sa trop grande consommation d'alcool, soit de son absence de consommation. Il a le sentiment global que personne ne l'aime.
Mary KILBORN parle de la confrontation et de l’ACP "La considération positive inconditionnelle confronte la croyance fondamentale que le client est nul. Pour les clients qui ont une faible estime de soi, l’acceptation du thérapeute peut être perçue comme déroutante." Je l’ai vérifié pour les alcoolodépendants
L'aidant laisse la personne avancer à son rythme, il la laisse maître de la direction de l'entretien dans l'ici et maintenant. Je me dis souvent que si le problème est en lui, la solution est donc en lui. Un vrai lâcher prise de ses dépendances lui permettra d'avancer vers la voie de la libération. C'est la personne elle-même qui sait ce dont elle souffre et dans quel sens elle doit aller pour se libérer. L'aidant doit aider l'autre à se libérer de ses angoisses. Plus l'aidant sera authentiquement congruent, plus l'aidé aura de chance pour changer.
L'aidant doit écouter en s'intéressant à l'autre, à ses émotions, à l'expression de ses sentiments.
Brigitte a son espace de liberté pendant nos rencontres. Je la sens bien "installée" dans le temps de l'entretien, comme si c'était une bouffée d'oxygène qu'elle prenait pendant cette heure. Elle peut laisser libre cours à ses sentiments. Aux émotions fortes que son passé fait ressurgir. Je ne fais que l'écouter, sans pratiquement intervenir sauf pour des reformulations quand les mots s'entrechoquent. J'ai l'impression que le fait que je me m'intéresse à elle est important pour elle. Elle se sent en sécurité.
"En étant reconnu et accepté par l’autre, le client apprend à se reconnaître et à s’accepter. Il se défend moins contre ce qu’il ressent ; il admet ce qui se passe en lui et pour lui. Il se comprend mieux et déjà s’unifie."
4.16. La supervision
Professionnellement je bénéficie d’une supervision, avec un psychanalyste, depuis plusieurs années déjà. Cette supervision est faite en équipe et ressemble plus à de l’analyse de la pratique.
Plus j'avance dans la structuration des entretiens, plus je m’implique personnellement et plus je ressens le besoin d’avoir un endroit pour interroger ce qui se passe en moi lors de ces entretiens. J’ai donc décidé d’avoir une supervision de type professionnelle / personnelle afin de questionner ma pratique et le sens de mes interventions.
Pour mieux coller à ma nouvelle façon de travailler, j’ai choisi une personne formée en relation d’aide. Pour moi, c’est un travail de soutien dans l’exploration de ma relation avec les personnes prises en charge.
Lors d’un groupe de parole, plusieurs participants exprimaient que pour eux le fait d’avoir un accompagnement les mettaient en sécurité. S’ils vivaient une situation difficile, ils savaient qu’ils pouvaient toujours m’en parler, même s’ils ne le faisaient pas. Je ressens la même chose pour ma supervision, je peux faire appel en dehors du prochain rendez-vous si j’en éprouve le besoin. C’est une sécurité pour moi.
Il s’agit également pour moi d’un accompagnement dans l’attention que je porte à l’appréciation de ma relation à l’autre. Cela m’aide à évoluer à travers questions et blocages vers un peu plus de cohérence dans mon travail. Elle me permet de devenir conscient des facteurs personnels qui sont des blocages au développement de l’empathie ou qui pourraient influencer ma capacité à libérer cette sensibilité dans ma relation d’accompagnement à l’aidé.
Cette supervision centrée sur la personne m’aide à progresser dans un climat de respect et de confiance à travers mes propres questions touchant à la fois les situations professionnelles vécues, la compréhension que j’en ai et ce que cela évoque ou même perturbe chez moi.
Elle m’aide, quand le doute s’installe, à prendre conscience de certaines qualités, à me détacher de certaines émotions et à être plus ouvert à moi et donc à l’autre afin d’offrir à la personne que j'accompagne le climat le plus propice à son expression.
La supervision me parait indispensable si je veux poursuivre un travail d’écoute.
Je me suis rendu compte qu'il me fallait une certaine maturité émotionnelle pour pouvoir accepter les émotions de l'autre sans me sentir menacé par mes propres émotions.
![]()
La relation d’aide à visée thérapeutique, nous l’avons vu, est axée sur une croissance personnelle de l’aidé et non sur la résolution de problème. Une alcoolisation gérée par disulfiram va régler le problème temporairement, mais ne va pas aider la personne à progresser vraiment.
Il est évident que tout ce que j'ai acquis pendant ces deux ans de formation, je vais continuer à l'exploiter au cours des entretiens individuels ou des groupes de paroles. Je souhaite même enrichir mes connaissances et poursuivre la recherche pour être plus aidant dans mes rencontres.
Je trouve que cette approche s'adapte bien au traitement de l'alcoolodépendance. Avec une action centrée sur la personne et non sur le symptôme. Mais dans le travail d'éducateur que j'effectue actuellement, même si les entretiens représentent une part importante de mon action, je ne fais pas que cela.
Je ressens certains freins à l'expression de l'aidé dûs à mes différentes casquettes.
Lucien ne paie plus son loyer depuis un moment. Dans les rencontres que nous avons, il est question de ce qu'il éprouve comme difficultés relationnelles. Je trouve ce travail intéressant. Mais je suis en même temps représentant du bailleur et dois faire encaisser le loyer. Une sanction institutionnelle est intervenue. Maintenant Lucien demande des rencontres avec moi "en dehors du boulot" parce qu'il en sent le besoin. Ce que je ne puis accepter.
Si je n'avais pas aussi cette casquette là, j'aurais pu continuer les entretiens avec lui plus facilement. Si Lucien avait été logé par un bailleur extérieur j'aurais pu continuer l'accompagnement jusqu'à pouvoir interroger une éventuelle expulsion.
Il est plus facile de travailler avec quelqu'un qui a un logement à son nom qu'avec une personne qui a un logement au nom de l'association. Donc faire en sorte d'organiser le service dans ce sens.
Même si j'essaie de travailler différemment dans des temps différents, ce n'est pas toujours facile.
Gilbert vient me voir pour un conseil sur sa lettre de démission. Je suis face à une demande directe et j'entends une demande sous-jacente.
Demande directe de rédaction de courrier et demande sous-jacente d'angoisse car cela ne va plus à son boulot, il se sent nul. Lui qui a cherché pendant près de 4 ans à trouver une place de cuisinier, lui qui vient de signer un CDD après plusieurs CES, veut démissionner. Ses collègues le prennent pour un imbécile, en plus ils boivent, lui ne supporte plus.
Dans cet exemple, j'ai différé la rédaction de la lettre à une prochaine rencontre et interrogé son ressenti, son angoisse.
Mais mon rôle n'est pas clair.
Ce que je vois comme hypothèse d'action actuellement se situe plus dans une organisation du travail, afin de passer le maximum de temps dans l'écoute des alcoolodépendants.
Quand les personnes vont bien dans leur tête le reste va tout seul.
Quelqu'un qui a réglé le problème avec l'alcool, c'est à dire avec ce qui dans son histoire l'a amené à utiliser l'alcool, est prêt à faire face aux difficulté sereinement. Cette personne trouve, sans l'aide de l'éducateur, un emploi adapté, un logement et un réseau de relations.
Je pense orienter mon action dans la direction de l'approche centrée sur la personne pour avoir une action plus efficace c'est à dire plus aidante, en me dégageant le plus possible des contraintes qui parasitent ce travail.
![]()
Plus j'aide les personnes à avancer dans l'exploration de leurs sentiments, plus je me rends compte que tout se joue (se noue) durant l'enfance. Ce n'est pas étonnant que leur rapport à l'alcool ait été si prenant. Pas étonnant qu'elles soient devenues dépendantes d'un produit qui leur a permis de vivre. L'alcool leur a permis de survivre à leur angoisse, il leur a permis de moins souffrir.
Si elles ne veulent plus avoir recours au produit, elles doivent remplacer l'alcool. Nous devons par l'écoute, les aider à soulager leurs angoisses.
Libérer les émotions est essentiel, sinon elles nous oppressent.
Il n'y a pas à intervenir, il y a à écouter. Il faut favoriser la prise de conscience des sentiments de l'aidé. Il faut être une sorte de miroir pour que la personne entende ce qu'elle dit. On peut faciliter cette attitude en reformulant, afin que l'aidé entende mieux ce qu'il vient de dire, et que je sois sûr d'avoir bien perçu ce qu'il veut me dire.
L'aidant découvre alors que son expression libère en lui une énergie nouvelle.
Il faut pouvoir accepter les révélations les plus choquantes, et pour cela il faut que l'aidé se sente en confiance, qu'il sente un aidant "présent" auprès de lui, qui ne portera pas de jugement. C'est dans ces conditions que l'on sent une libération chez la personne en face de vous. Malgré ce que l'aidé vient de dire, l'aidant est toujours là, présent. Le risque qu'il redoutait "si je dis ça on va encore me rejeter" ne s'est pas produit.
A la suite de révélation sur son histoire Robert pensait : "S'il sait cela, il ne restera pas là, avec moi." Et malgré ce qu'il pensait, je suis resté.
L'écoute doit être inconditionnelle, elle ne doit porter aucun jugement et n'imposer aucune condition. Les alcoolodépendants n'ont été que trop jugés de par leur comportement. Quand ils sont en période de consommation, celle-ci est trop forte pour l'entourage. En période d'abstinence, elle est trop faible pour l'entourage. La norme est : " A consommer avec modération".
L'entretien est d'abord une rencontre entre deux personnes. Deux personnes qui vont s'apprivoiser et cheminer ensemble. L'une étant là pour aider l'autre, pour l'aider à faire face à ses difficultés du moment. Ces entretiens centrés sur l'expérience de la personne permettent à l'autre de trouver les capacités, qu'il possède en lui, pour que ses souffrances, ce mal être se transforme en bien être, grâce à une relation profonde et authentique. Ces entretiens de relation d'aide doivent être vécus, avant tout comme une relation humaine.
Au début de nos rencontres, Henri cherchait à avoir une relation privilégiée avec moi. Il ne voulait pas que je sois un "fonctionnaire", comme il le disait, "il voulait une relation vraie" Je lui répétais qu'une relation professionnelle était avant tout une relation humaine. Grâce à mon attitude il s'est senti écouté et considéré comme une personne humaine.
Il faut favoriser le laisser être. Il faut aider l'alcoolodépendant à repérer ses angoisses, à les identifier, à les verbaliser, sinon il va les subir et passer à l'action. Etre vrai, c'est être pleinement soi-même. Etre attentif à l'intensité de l'expression de la vie intérieure. Communiquer en approche centrée sur la personne, c'est être en relation avec l'autre tout en restant en relation avec soi. Il faut aller au fond de soi, accueillir les émotions et l'expression de ses propres sentiments, pour pouvoir recevoir l'autre dans ce qu'il est vraiment.
Certaines des personnes font appel quand ça va mal. Quand la situation s'arrange, tout va bien, plus la peine d'aborder les problèmes, de les faire remonter à la surface. "Faut pas remuer la merde, sinon ça sent" me disait l'un d'eux.
Je leur dis quelques fois : "Ce n'est pas quand il pleut que l'on refait le toit de sa maison."
L'approche centrée sur la personne permet un "mieux vivre" mais n'efface pas pour autant les difficultés même si "Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, nous pouvons les empêcher d'y faire leur nid."
![]()
Dernière modification le 17/03/03